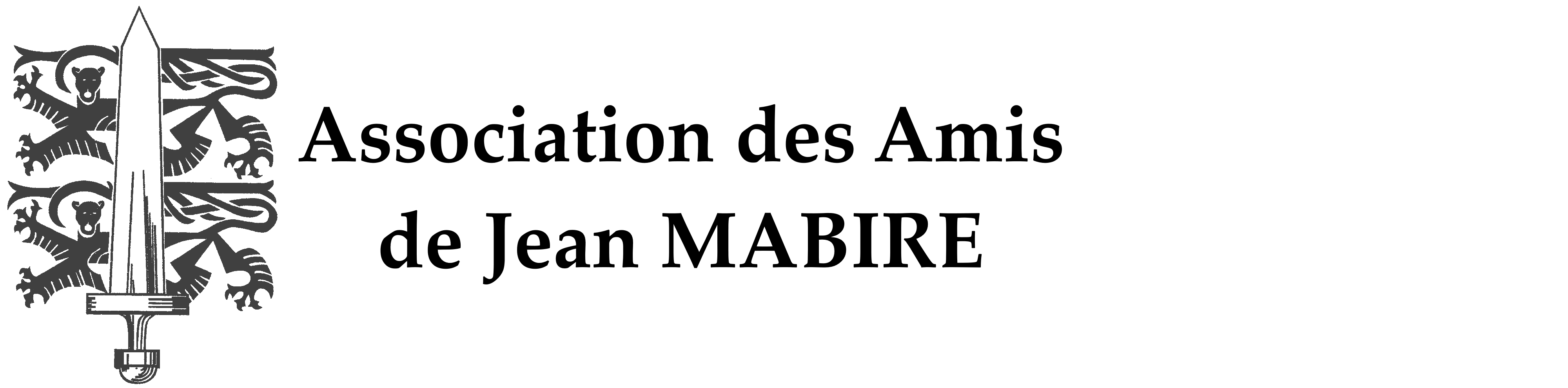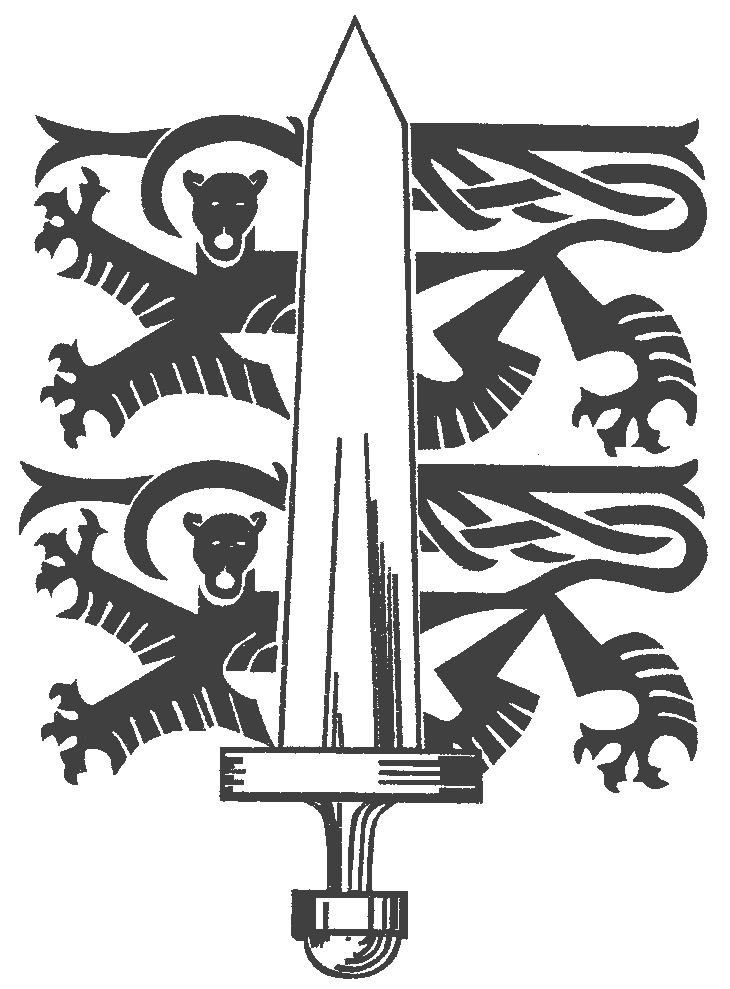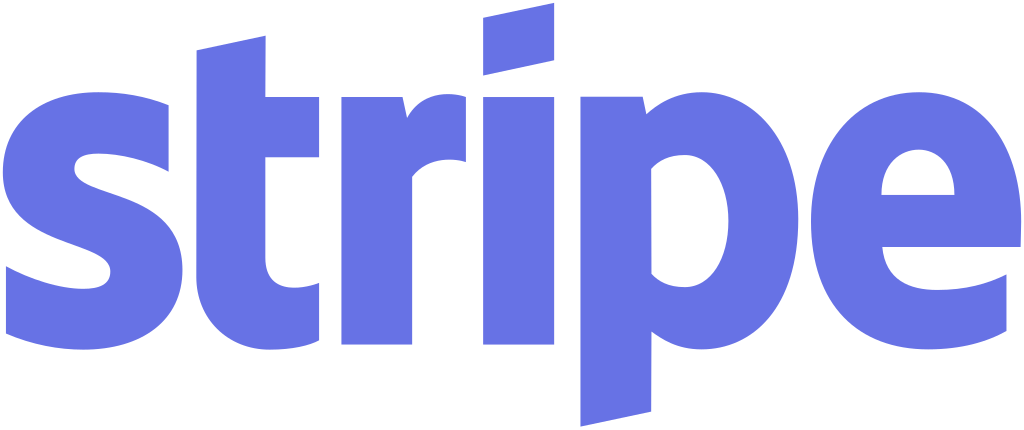Je suis d’un pays où le gris est la plus belle des couleurs.
Entre le noir et le blanc, chaque ton prend sa juste valeur. Le plomb des vagues. La suie des nuages. Ce jour-là, c’était en décembre, quand l’automne roux — la plus splendide des saisons — s’incline devant l’hiver gris. Je voulais voir la mer. Le plus près de Paris, c’est Dieppe (les voyageurs et les gastronomes le savent qui apprécient ses filets de sole et son bateau pour New Haven). Le plateau de Caux se drapait dans des solitudes horizontales, un peu hollandaises, un peu danoises, qui sentaient déjà la Baltique et nos forteresses perdues. Chaque ferme, dans la brume matinale, respirait l’avarice et l’audace. De Ganger Rolf, premier duc, à Mait’Louis, roi sur sa terre, les hommes de chez moi ont des moustaches de coureurs de mer et des yeux· à faire basculer l’horizon.
Sur le rivage tout perdait sa couleur pour trouver sa nuance. Un beau travail de cinéaste ennemi du technicolor… Les falaises à pic dans la respiration de la mer, toute cette vieille craie usée et humide, avec le duvet d’herbe rase, frissonnant dans le vent froid. Le gazon du front de mer avait aussi perdu sa belle teinte vert vif qui, l’été, fait songer à un golf.
Le rempart des galets cachait les vagues et leur dernier rouleau. On entendait seulement des coups de canon et le grondement de tous ces cailloux qui se frottaient en gémissant. Toujours le vent. Des gerbes d’écume claquaient sur la jetée. Douche glacée. Le goût du sel sur les lèvres. Appuyé sur le parapet, on s’imaginait au grand large. Les mouettes volaient plus bas que nous, au ras de l’eau. Elles cherchaient leur vie, avec des cris brefs. Fraternels. Ce sont là des images. Des souvenirs. Des rêves. Le froid qui grimpe dans les os. Et pourtant, on est bien. Tout est possible. La mer grise et le ciel gris ne parviennent pas à se séparer maintenant que la pluie est en train de tout noyer. Les vagues ne se lassent pas.
Jamais. Le vent les creuse, les écrête, les brise contre les galets. La mer partout. C’est la plus belle du monde. Le chemin de l’aventure. Oui, tout est possible. Il ne faudrait pas tellement de toile pour rejoindre nos lointaines colonies : l’Angleterre, l’Amérique. Là-bas, ceux de ma race ont réussi’ des choses étonnantes : la vapeur, les Indes, le cosmos. La jetée de bois, sculptée par les embruns, vibre. Des mousses ont gravé au couteau des serments naïfs sur la rambarde. Tout mon pays meurt d’envie d’appareiller. Les flèches des cathédrales escaladent le ciel comme des mâtures. Partir au grand large, comme nous en sommes venus voici mille années.
Et tout emporter avec nous : la patience, la songerie, le courage, la méfiance et une belle moisson d’enfants blonds. Mon pays, c’est la mer. Couronne des escales autour de mon royaume : Southampton, Edinburgh, Bergen, Copenhague, Hambourg, Brême, Rotterdam, Antwerpen, que les Français appellent Anvers, Dunkerque. Dunkerque, si loin de Tamanrasset, si près des jours de mai 40 où j’ai perdu la France sur les routes. Dunkerque, le nom qui de tous me fait le plus mal, avec ces dunes où le sable efface tant de pas, où le vent emporte tant de paroles, où la pluie arrache tant de larmes. Dunkerque et Penmarch, qu’ils sont beaux les noms de mes amours ! Voilà. Ce jour-là, j’étais à Dieppe comme dans un film en grisaille subtile. J’aurais pu aussi bien me trouver à Fécamp ou à Barfleur. Mais la mer n’y est point si grise et j’avais besoin de gris.
J’essayais de trouver ce qu’il me fallait écrire sur le Nord et sur le froid. Je ne trouvais rien d’autre à offrir que cette morsure de la pluie salée et glaciale, rien d’autre que cette certitude absolue que j’étais heureux. Heureux et triste. Pas commode à expliquer.
Mais nous ne sommes pas toujours des gens commodes. Que seraient pourtant les pays sans les hommes ? La mer sans les marins et les noyés ? Celui-là, il était nu sur une table, dans une mairie de village, au pays des Côtais, sur cette immense grève, infinie et basse, d’où on guette les Îles, comme un mur écroulé, des Chausey à Aurigny. Ce que je raconte, c’est une histoire qui m’a été rapportée. Presque une légende. À cette époque, j’avais une quinzaine d’années et le rivage de mon enfance était devenu zone interdite. Verboten. Des gamins à peine plus âgés que moi y avait retrouvé les tranchées que je creusais avant-guerre dans les dunes, avec mes cousins et ceux de notre bande ; ils y avaient coulé le béton des forteresses inutiles. Plus tard, beaucoup, plus tard, on m’a parlé du noyé. C’est le secrétaire de mairie qui m’a raconté l’histoire. Difficile d’identifier cet inconnu vomi par le jusant. Il était nu, je crois l’avoir dit. Un grand type à la peau claire, un visage allongé, des cheveux plutôt roux collés sur les tempes.
On avait baissé les paupières sur des yeux bleu pâle.
Comme il avait le type nordique, on avait prévenu la Kommandantur. On attendait. « Ce pourrait bien être un gars de chez nous » dit un paysan. « Ou bien un Anglais » répondit un autre, avant qu’intervint un troisième : « Sans doute un Allemand ». Il y eut un assez long silence. Quelqu’un conclut : « Tout ça, c’est la même race ». On n’attacha pas d’importance particulière à cette remarque, tellement évidente, et on alla vider une moque de cidre au plus proche débit, quand les gendarmes eurent emmené le corps.
C’est une histoire qui me hante, surtout à l’heure où la mer rend les noyés. Le racisme théorique, avec ses mensurations et ses querelles, m’assomme.
Mais je ne pourrais jamais m’empêcher d’aimer jusqu’à la déraison un certain type humain. Aujourd’hui, je suis tout autant Rhodésien que Normand — Rhodésien parce que Normand. C’est une question de famille. On aime ses frères ou pas. Je pense souvent à Drieu La Rochelle que l’on disait inconstant parce qu’il aimait à la fois les Britanniques et les Allemands, les Yankees et les Russes. Avant son premier suicide, en août 1944, dont on ne le sauva que par hasard, il se promène une dernière fois dans Paris.
Il regarde les SS qui montent vers le front de Normandie. L’envie folle le prend de partir se battre avec eux. Ou contre eux — mais dans un régiment écossais. Il le raconte dans son Journal (encore inédit, hélas). Ce doit être cela, le Nord. Un pessimisme actif, un type de héros ultra-volontaire et ultra-sentimental que l’on retrouve dans les romans de Knut Hansum ou de Jack London. Et aussi la beauté. Une beauté qui immobilise le mouvement et donne une image de l’infini. « Millénaire jeunesse, Grèce que j’aimais » chantait Jean Turlais dont les poèmes restent les plus émouvants mots de passe d’une génération d’enfants perdus. On me croit à l’autre bout du continent, égaré dans la brume et le délire. On m’attend au cap Nord. Mais je rêve des Cyclades tout autant que des Lofoten. Les soldats de Salamine et les rois d’Uppsala avancent d’un même pas. Un casque trouvé dans une tombe danoise donne au fantôme du père d’Hamlet le masque guerrier d’Athéna.
Les colonnes d’un temple ou le bordé des drakkars, l’or ouvragé surgi des steppes, les chevaux domptés et les muscles durs. Comment diviser mon sang ?
L’Europe est toujours au nord de l’Orient. Le Spartiate mort au soir des Thermopyles a la beauté tragique de ce seigneur de la mer allongé dans son vaisseau royal pour un dernier voyage. Ses fidèles le poussent vers le large. Un bûcher au pied du grand mât. Une torche. Il ne sera bientôt plus qu’un feu sur la mer. Ils ont le même visage que le noyé de mon pays. Visage de Polyclète et du chevalier de Bamberg. Visage calme et grave sous le casque couronné de feuillages des derniers soldats d’Occident.
Visages d’os, de chair et de sang qui sont notre héritage et notre espoir. « Il n’est de richesse que d’hommes », aime à répéter Saint-Loup. Admirable formule.

Cahiers-Universitaires-30_1967_Froid-Nord
Je n’aurais attendu que ma quarantième année pour me dégoûter, définitivement j’espère, des abstractions de la philosophie et des jongleries de la politique. Ce qui compte dans toute aventure humaine, ce sont les amis avec lesquels on les mène. Beaucoup des miens sont morts vers leur trente-cinquième année.
Je les ai peu connus, mais je sais qu’ils auraient sans doute été mes meilleurs amis, sans ma vie et sans leur mort. Nous ne nous comprenions pas très bien parce qu’ils étaient en avance sur moi. J’envie parfois la manière si singulière dont ils ont su nous quitter. G. disparu corps et bien avec son cotre au large d’Ouessant. V. sauté sur une mine dans une jeep bourrée de munitions et d’explosifs. T. précipité au fond d’une crevasse au-dessus des Bossons en voulant sauver une vie (la mienne). N. foudroyé au volant d’une voiture qui roulait à près de 200 à l’heure sur l’autoroute. J’ai aussi sans doute croisé D. au hasard des étapes algériennes, mais lui, le fusillé, appartenait déjà à un autre monde. Au lieu d’un article, je suis en train d’écrire un bilan. Peu importe.
Je ne m’éloigne pas. Je ne m’éloigne jamais. Surtout quand je ne réponds pas aux questions et aux attentes. Mais comment parler du Nord sans parler de moi ? Depuis des années, je voudrais même dire depuis toujours, mais le plus loin que je remonte, ce doit être vers 1937 sur les bords du lac de Constance, j’appartiens à un monde que j’ai baptisé « nordique » parce que c’est un mot qui a l’avantage de n’être pas trop précis et de ne point m’enfermer dans les limites étouffantes d’une doctrine. C’était cela que je reprochais au Sud : la frontière, le fini, la loi. Rome enfermée dans une définition immuable et fragile de l’Empire. Les champs au cordeau, l’alignement des vignes et des légions, la mer tiède qui a perdu sa respiration… Au bout, le Sahara. Comme nous gardons la fascination de notre passé. Peuple des forêts qui nous souvenons des déserts et des tentes de peau.
Et des glaciers. Europe des lacs de Mazurie et des collines de Corinthe, Europe qui ne se tiendrait pas droite sans le squelette des Alpes. Comme on a tort de vouloir m’enchaîner au banc d’un doris, « nageant » au large de l’Islande. Bien sûr, je cherche sans fin l’Ultima Thulé, mais je connais aussi le prix du marbre brûlant à l’heure de midi et la morsure des aiguilles de glace, quand le piolet fait jaillir des étincelles de neige et de givre. Qui n’a rêvé de hisser le pavillon noir des corsaires sur les 5.629 mètres de l’Elbrouz, aux confins de l’Europe et de l’Asie, de l’Occident et de l’Orient, dans ce Caucase éternel où Prométhée, après avoir dérobé le feu du ciel, souffre et triomphe à jamais avec tous ceux de notre race ? Le froid, ce n’est pas seulement le Nord. C’est aussi le plus haut, le plus pur et — par un lumineux paradoxe — le plus près du soleil.
JEAN MABIRE
Cahiers Universitaires 67, n°30, Janvier-Février 1967, Nord-Froid
Couverture de Jeannine Mabire